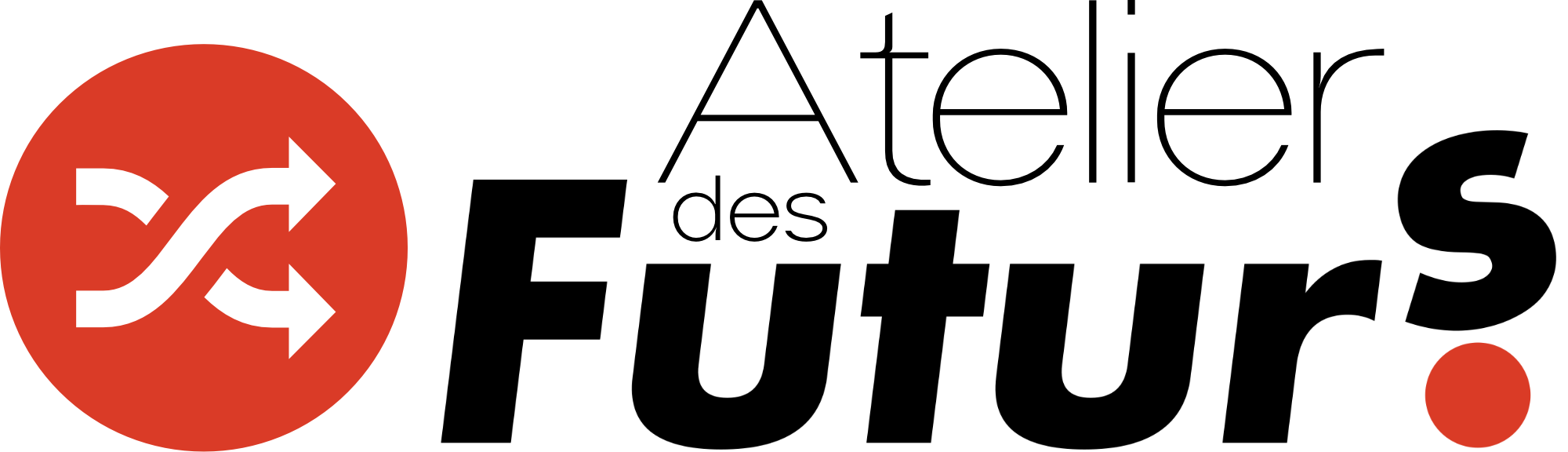Extraits
s'inspirer pour mieux imaginer
Nos compétences sont fonction de nos outils. Notre façon de nous orienter dans l’espace, ou notre perception du territoire ne sont pas les mêmes selon qu’on sait ou non lire une carte (technique cognitive dépendant elle-même de l’établissement de cartes routières accessibles, soit d’un moment précis dans l’histoire de l’imprimerie et des réseaux routiers).
La remémoration non plus n’est pas un processus purement psychologique, car notre capacité de mémoire dépend des mnémotechniques à disposition (écriture, livre, numérique, etc.).
Le vrai théoricien ressemble au maître nageur qui fait pratiquer sur la terre ferme des mouvements qui paraissent grotesques et exagérés à ceux qui oublient qu’ils doivent être exécutés dans l’eau. Voilà pourquoi les théoriciens qui n’ont jamais fait eux-mêmes le plongeon, ou qui n’ont su tirer de leurs expériences aucune idée générale, sont inutiles et même absurdes, car ils se bornent à enseigner ce que chacun sait déjà : la marche.
Mais dans la grisaille du monde réel, échappant à l’attention des hommes, flotte cette petite chose qui le transcende, comme un petit grain de poussière qui se serait échappé du pays des rêves pour nous laisser entrevoir l’immensité et le mystère de l’univers, pour nous suggérer que dans cet univers existe peut-être un autre monde, entièrement différent de notre réalité…
Si une situation contient des possibilités, mais qu’elles sont hors de notre modèle [mental], c’est comme s’il n’y avait rien. Nous ne pouvons pas les percevoir. Elles sont hors du champ de vision.
Il n’y a en réalité jamais de score final dans le monde du changement continu. Ce qu’on appelle « victoire » est en fait un temps d’avance en début de partie. Par ailleurs, les organisations qui ont vraiment du succès ne sont pas celles qui se lancent pour vaincre la concurrence mais celles qui se concentrent sur la globalité de l’environnement plutôt que sur la compétition.
Un soldat combat toujours dans l’espoir de parvenir à la paix. Elle est son horizon ultime. Mais si le politique a décidé de l’engager dans l’atteinte d’un tel objectif, c’est pour qu’il s’y efforce en faisant son métier de « soldat de guerre ».
Puisque nous sommes soldats, il ne faut pas nous envoyer à la bataille en imaginant que nous pourrions ne pas avoir à combattre. Ou que nous pourrions ne combattre que modérément, avec la retenue qui sied à nos pudeurs de démocrates. Un soldat ne peut pas se lancer dans la terrible mêlée sans être happé par cette exigence, puissante, du déchaînement de la violence.
Il s’y confrontera avec toute son énergie, toute son intelligence, tout son courage. Avec tous les moyens disponibles également. Et qui doivent être rassemblés en qualité et en quantité suffisantes pour vaincre. À la guerre, la ratiocination et les calculs de rentabilité exposent au risque de l’impuissance et de la perte de tout crédit.
Quelles que soient la taille et la force de l’ennemi, le combat est un engagement extrême, individuel et collectif, auquel il ne faut se résoudre que si l’on est prêt à en assumer le coût.
Les modèles mentaux ce n’est pas le «à quoi je pense/nous pensons», c’est le «comment je pense/nous pensons», c’est-à-dire les hypothèses, les croyances et les valeurs individuelles et collectives que nous formons sur le monde qui nous entoure.
Ce sont des lunettes filtrantes; en langage plus savant, c’est un «cadre de référence».
L’amour est une contrée vierge. Chaque pas qui nous en rapproche nous transforme. Nous grandit. Change la géographie de qui nous sommes. Et si on est assez courageux pour y pénétrer seul et y trouver sa place, on ne connaîtra plus jamais la solitude parce qu’on est arrivé à vivre dans tout ce que l’amour touche.
Est-ce que nous aurions maintenant des wagons chauffés, même quand il fait froid au mois d’octobre, contrairement aux dispositions réglementaires ? Est-ce que nous aurions des compartiments proprement époussetés ? Est-ce qu’on délivrerait des billets d’aller et retour, comme au bon temps, entre Amiens et Paris ?
Imaginons maintenant que le pouvoir n’ait plus besoin de la collaboration humaine. Que sa sécurité – et sa force – soit garantie par des instruments qui n’ont pas la possibilité de se révolter contre lui. Une armée de capteurs, de drones, de robots capables de frapper à n’importe quel moment, sans la moindre hésitation. Ce serait, finalement, le pouvoir dans sa forme absolue.
Tant qu’il se fondait sur la collaboration d’hommes en chair et en os, tout pouvoir, aussi dur fût-il, devait compter sur leur consentement. Mais quand il sera fondé sur des machines qui maintiennent l’ordre et la discipline, il n’y aura plus aucun frein.
Le problème des machines n’est pas qu’elles se rebelleront contre l’homme, c’est qu’elles suivront les ordres à la lettre.
Il n’y a qu’à imiter la nature, car elle ne se trompe jamais.
Chacun, suivant son tempérament, pourra choisir le climat invariable qui conviendra à ses rhumes ou à ses rhumatismes, sur un globe où l’on ne connaîtra plus les variations de chaleur actuellement si regrettables !
Votre père était un artiste. Ce mot dit tout. J’aime à penser que vous n’avez pas hérité de ses malheureux instincts. Cependant, j’ai découvert en vous des germes qu’il importe de détruire. Vous nagez volontiers dans les sables de l’idéal et, jusqu’ici, le résultat le plus clair de vos efforts a été ce prix de vers latins, que vous avez honteusement remporté hier.
Observé sur la longue durée, d’après ses faits et non ses dires, le politicien de la pensée qu’est l’intellectuel s’avère aussi acoustico-dépendant que le politicien tout court : il va là où le mot «porte», et peut le mieux réverbérer sur les «gens qui comptent».
L’intellectuel est d’abord l’homme de l’efficacité, l’intelligence passe après (elle n’est pas définitoire, en dépit des apparences)
[…] la superposition quantique des états laisse ouverte la possibilité de faire un choix différent de celui que l’on avait initialement envisagé de faire, au moment même où l’on décide de le mettre en oeuvre: passer de l’acte (choisir) a modifié la préférence initiale !
Quant à moi, dit le marin, que je perde mon nom si je boude à la besogne, et si vous le voulez bien, monsieur Smith, nous ferons de cette île une petite Amérique ! Nous y bâtirons des villes, nous y établirons des chemins de fer, nous y installerons des télégraphes, et un beau jour, quand elle sera bien transformée, bien aménagée, bien civilisée, nous irons l’offrir au gouvernement de l’Union ! Seulement, je demande une chose.
— Laquelle ? répondit le reporter.
— C’est de ne plus nous considérer comme des naufragés, mais bien comme des colons qui sont venus ici pour coloniser !
Au fond, les seules révolutions qui échappent au sens astronomique du mot, ce ne sont pas les politiques, mais les révolutions techniques parce qu’elles seules sont sans retour. On ne revient pas à la bougie après l’électricité, ni à la marine à voile après la machine à vapeur, comme on revient à la religion orthodoxe après la révolution d’Octobre et à Confucius après la Longue Marche. Internet et les containers ont changé la face du monde bien plus sérieusement que Marx, Lénine ou Mao
Vous avez commis l’affreuse erreur, m’a-t-il dit, de confier vos établissements scientifiques à des scientifiques ayant pignon sur rue, en qui vous aviez confiance. Mans ce sont surtout les jeunes chercheurs peu dignes de confiance qui apportent les idées nouvelles. Vous continuez de faire quelques petites trouvailles, mais vous avez perdu l’impulsion nécessaire.
Dans mes romans, j’appuie mes prétendues inventions sur une base de faits réels. J’utilise pour leur mise en œuvre des méthodes et des matériaux qui n’outrepassent pas les limites du savoir-faire et des connaissances contemporaines.
Face à l’incertain et au brouillard de l’action, c’est moins de puissance cérébrale que de sagesse dont on a besoin, et la sagesse ne peut s’acquérir que sur le terrain à partir d’une posture d’humilité malheureusement peu commune chez les esprits supérieurs.
L’apprenance, comprise comme la condition de l’engagement dans l’acte d’apprendre, relève en quelque sorte originellement d’un mystère.
Cette métaphore de la caverne pose donc la question de l’apprenance en identifiant la situation paradoxale de cette mise en mouvement d’un être condamné à être libre pour advenir à lui-même.
Ennuyons-nous les uns les autres ! Voilà la règle !
« Par le commencement », avait dit Cyrus Smith. Or, ce commencement dont parlait l’ingénieur, c’était la construction d’un appareil qui pût servir à transformer les substances naturelles. On sait le rôle que joue la chaleur dans ces transformations. Or, le combustible, bois ou charbon de terre, était immédiatement utilisable. Il s’agissait donc de bâtir un four pour l’utiliser.
– À quoi servira ce four ? demanda Pencroff.
– À fabriquer la poterie dont nous avons besoin, répondit Cyrus Smith.
– Et avec quoi ferons-nous le four ?
– Avec des briques.
– Et les briques ?
– Avec de l’argile.
En route, mes amis. Pour éviter les transports, nous établirons notre atelier au lieu même de production. Nab apportera des provisions, et le feu ne manquera pas pour la cuisson des aliments.
« … L’oeil humain est fait pour survivre dans la forêt. C’est pour cette raison qu’il est sensible au mouvement. N’importe quelle chose qui bouge, même à la périphérie la plus extrême de notre regard, l’oeil la capte et transporte l’information au cerveau. En revanche, tu sais ce que l’on ne voit pas? » J’avais secoué la tête.
« Ce qui reste immobile , Vadia. Au milieu de tous les changements, nous ne sommes pas entraînés à distinguer les choses qui restent les mêmes. Et c’est un grand problème parce que, quand on y pense, les choses qui ne changent pas sont presque toujours les plus importantes. »