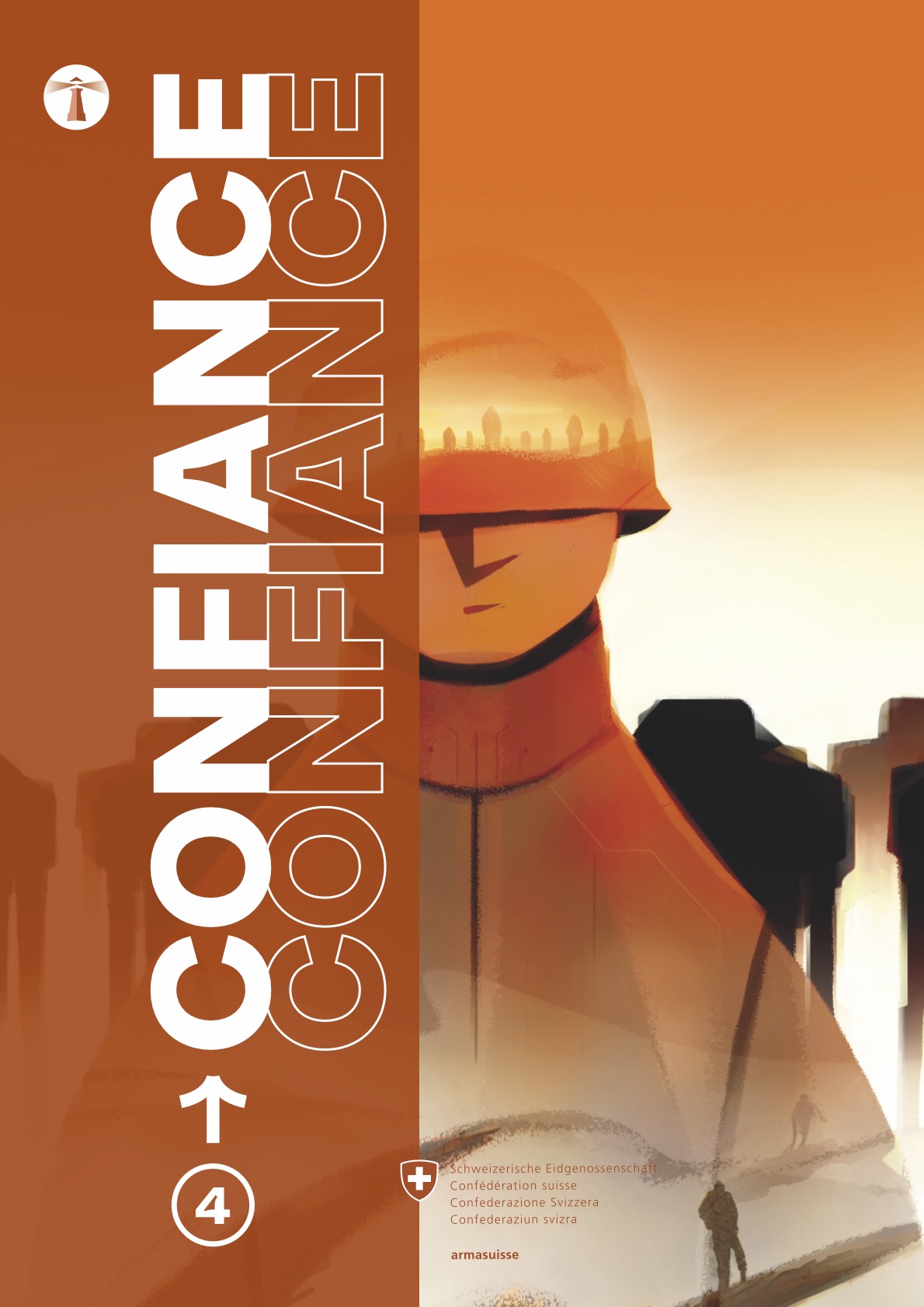Antoine Pellion est un Haut fonctionnaire français. De juillet 2022 à février 2025, il a été Secrétaire général à la planification écologique.
Dans l’entretien à suivre, Antoine revient sur le modèle français de planification écologique et montre que l’opposition entre fin du mois et fin du monde n’a plus lieu d’être : réussir la transition écologique est une condition essentielle pour garantir la survie économique de la France et de l’Europe.
En se remémorant ensuite la création en 1947 du plan comptable général, il éclaire la nécessité – aujourd’hui – de compter ce qui compte et de se doter d’une grille de lecture biophysique pour structurer une action collective compatible avec les limites planétaires.
En conclusion, Antoine insiste sur un levier qu’il faut rapidement activer : la confiance. La confiance d’agir seul, la confiance d’agir à plusieurs, la confiance d’agir résolument et progressivement. Et c’est précisément à cela que doit servir un plan.
Entretien enregistré le 10 septembre 2024
Remerciements : agence Logarythm
Entretien enregistré le 17 mars 2025
Remerciements : agence Logarythm

Transcript de l’entretien
(Réalisé automatiquement par Ausha, adapté et amélioré avec amour par un humain)
Thomas Gauthier
Bonjour Antoine.
Antoine Pellion
Bonjour.
Thomas Gauthier
Alors ça y est, vous y voilà, vous êtes face à l’oracle. Vous allez pouvoir lui poser une et une seule question.
Quelle est-elle ?
Antoine Pellion
Bien, bonjour à tous. Alors, cette question, moi, elle me préoccupe beaucoup.
Je vais la formuler le plus simplement possible, qui est de dire quel est l’impact du changement climatique sur l’évolution de la forêt et des terres agricoles dans les 10-20 prochaines années. Et cette question-là, elle est extrêmement centrale et je voudrais vous expliquer pourquoi, parce qu’on peut donner l’impression que c’est un petit bout de la lorgnette et que finalement, on ne traite pas l’ensemble du sujet avec cela.
Je vais commencer par un chiffre. qui pour moi m’a beaucoup frappé, que j’ai découvert, qui concerne la France. Et ce chiffre, c’est le suivant.
Alors même que la forêt française s’étend chaque année en surface, il y a de plus en plus de surfaces boisées chaque année, la croissance de bois, donc le rythme avec lequel pousse la forêt, a été divisée par deux en dix ans, entre 2010 et 2020. Et ce rythme de division par deux, il est en train de se prolonger, puisque là, ce que l’on observe, c’est une nouvelle division par deux. entre 2020 et 2030.
Et ce sujet-là, il ne concerne pas uniquement la forêt française, il concerne aussi d’autres forêts en Europe, dans le monde. Dans l’Est de l’Europe, il y a une ancienne forêt primaire où on vient de découvrir, les scientifiques viennent nous dire, qu’elle commence maintenant à relarguer des gaz à effet de serre, alors que la forêt, vous le savez, c’est normalement un puits de carbone, ça capte les gaz à effet de serre.
Et ce mécanisme-là, les scientifiques ne savent pas encore très bien le décrire, et donc on n’est pas sûr de savoir s’il va… s’accélérer, se ralentir. Or, il va être extrêmement déterminant pour plusieurs choses.
D’une part, comme je viens de le dire, tous nos espaces naturels, donc j’ai parlé de la forêt, mais ça vaut aussi pour les terres agricoles, ça vaut pour tous les écosystèmes en réalité, dès qu’il y a de la matière organique qui pousse, ils captent le carbone pour grandir. Et donc, il y a une des grandes questions qui est finalement, dans les années qui viennent, est-ce que ce carbone pourra toujours être capté au temps ?
Et si ce n’est pas le cas, ça va avoir des conséquences d’accélération du changement climatique très fort. Et puis il y a une autre dimension importante qui est que derrière cette question de la matière organique, que ce soit les arbres ou les plantes, il y a une question de production de ce qu’on appelle la biomasse, cette matière organique.
Et en fait, elle est très utile, cette biomasse, à la fois pour l’alimentation, mais aussi pour les biomatériaux, pour les bioénergies. Et on va y revenir, je pense, dans ce podcast, toute la transition écologique, notamment l’évolution… de notre consommation d’énergie, de nos matériaux, etc.
Elle repose beaucoup pour qu’on y arrive, pour qu’on réussisse le défi de la lutte contre un changement climatique sur notre capacité à utiliser cette biomasse. Mais pour l’utiliser correctement, encore faut-il qu’il y en ait.
Et là, il y a un vrai point d’interrogation aujourd’hui et c’est un vrai sujet de préoccupation très forte.
Thomas Gauthier
Alors en partant Antoine avec le sujet de la forêt et des terres agricoles, ce qui me vient à l’esprit c’est que vous nous parlez là de la biophysique finalement, de l’environnement dans lequel nous vivons et dont nous vivons, pour reprendre les mots de Pierre Charbonnier. Elle est où la physique, elle est où la biologie dans la décision publique ?
Est-ce qu’elle se trouve quelque part dans des textes ? Est-ce qu’on la trouve dans la constitution, dans d’autres textes de loi ?
Est-ce qu’on peut en faire fi ? Ou alors est-ce qu’on a finalement des garde-fous qui font que… la biophysique et les limites biophysiques ne sont jamais loin de la fabrique de la décision ?
Antoine Pellion
Alors, c’est une excellente question. Ces limites biophysiques, la réalité, c’est qu’elle est rarement explicite dans toute la fabrication des textes juridiques, des lois, de la constitution et puis de nos réglementations.
Elle est un peu dans la constitution, puisque la charte de l’environnement, elle institue finalement l’enjeu de protection du vivant et donc derrière aussi la biophysique. Mais cette biophysique, elle est souvent… implicite et jamais très explicite.
Et tout l’enjeu, du coup, des travaux que l’on mène au secrétariat général à la planification écologique, c’est de remettre en haut de la pile ces questions très physiques, parce que finalement, quand on parle de baisse de gaz à effet de serre, quand on parle de biodiversité, quand on parle d’accès aux ressources, je pense par exemple, on a parlé de la forêt, mais on pourrait parler aussi de la ressource en eau, qui va être un sujet extrêmement clé dans les prochaines années, les prochaines décennies. Quand on parle aussi des enjeux de santé et environnement, on parle de de polluants, on parle de pyphase, on parle de substances chimiques dans l’eau, par exemple.
On est à chaque fois sur des enjeux biophysiques, avec des enjeux souvent à la fois de flux, c’est-à-dire on en consomme combien chaque année, on est exposé à quelles substances, etc. Et puis des enjeux très importants de stock, c’est-à-dire il y en a combien sur Terre, on en a utilisé combien, est-ce qu’on va du coup au-devant de ressources rares avec potentiellement des sujets de pénurie ?
Et un des enseignements extrêmement forts des travaux de planification, c’est que quand on travaille sur les gaz à effet de serre, très vite, on arrive, on touche du doigt le sujet principal qui est la finitude de nos ressources naturelles et le fait que maintenant, ça y est, on touche un certain nombre de limites physiques. Donc j’ai parlé de la biomasse, l’eau par exemple, je vous donne aussi un chiffre sur l’eau, un scénario où le monde se réchauffe de 3 degrés, ce qui est pour l’instant le scénario le plus probable.
En France, conduirait à ce que le réchauffement soit de 4 degrés. Et 4 degrés, il y a plus d’eau dans l’atmosphère et moins d’eau sur Terre.
Il fait plus chaud, donc l’eau s’évapore un peu plus. Et donc, à pluviométrie inchangée, donc il pleut toujours autant, à la fin, on a moins d’eau sur Terre parce qu’il y en a plus qui s’est évaporée.
Et ce moins d’eau, c’est une baisse du quart de l’eau disponible aujourd’hui, moins 25%. C’est plus, on perdrait en quantité d’eau disponible, plus que l’intégralité de ce qu’on prélève aujourd’hui. est dix fois plus que l’eau que l’on consomme aujourd’hui.
Et donc ça, c’est une limite physique très forte. Et c’est pour ça que la planification écologique, donc le SGPE, il a été placé auprès du Premier ministre.
C’est pour faire en sorte qu’on ait les outils pour que toute cette biophysique, finalement, elle irrigue la décision publique jusqu’au plus haut sommet de l’État, auprès du Premier ministre, et qu’elle touche toutes les politiques publiques, bien sûr d’écologie, mais aussi de transport, d’aménagement, de… industrielle, la politique de la santé, la politique aussi de l’emploi, de la formation, puisque tout ça est concerné en réalité, rien n’échappe. On pourra reparler aussi, si vous le souhaitez, même les armées, dans cette actualité très forte aussi sur les enjeux de défense.
Rien n’échappe à ce sujet de la transition écologique au sens large, avec toutes ses dimensions, incluant l’adaptation au changement climatique.
Thomas Gauthier
Alors, vous avez à juste titre parlé du SGPE, de la planification écologique. Je lisais il y a quelques jours un article dans un grand quotidien français. qui faisait référence au grand renoncement en matière d’écologie, de transition, de planification.
Qu’est-ce à dire ? Qu’est-ce que l’on peut dire aujourd’hui de l’actualité qui est largement, effectivement, structurée autour des tensions géopolitiques dont on reparlera peut-être ?
Elle en est où, la planification ? Elle en est où, la transition écologique ?
Est-ce qu’il y a vraiment un coup d’arrêt ? Est-ce que c’est conjoncturel ?
Est-ce qu’on doit s’attendre à quelques semaines, quelques mois, quelques années de renoncement ? Ou alors est-ce que c’est vraiment… une sorte de point d’orgue médiatique aujourd’hui qu’on est en train de vivre.
L’écologie a disparu, mais elle va rapidement revenir.
Antoine Pellion
Alors plusieurs choses. Moi, je suis vraiment partisan.
Je pense que c’est important pour qu’on puisse continuer à avancer, qu’on regarde les choses un peu factuellement et lucidement et qu’on ne regarde pas uniquement le verre à moitié vide, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne fonctionne pas, parce qu’il y en a toujours énormément de choses qui ne vont pas bien. Et qu’on regarde aussi le verre à moitié plein, parce que c’est… riches de nos victoires individuelles et collectives, qu’on peut continuer à aller de l’avant et accélérer.
Alors le verre à moitié plein, c’est qu’on n’a jamais autant baissé nos émissions de gaz à effet de serre en France. Depuis le début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, 2017, donc jusqu’en 2024, on a baissé de 20% nos émissions de gaz à effet de serre en France.
Et le rythme de baisse s’est accéléré. En gros, on baissait de 1% par an avant 2017, on est passé à 2%, puis…
En 2023, on a baissé de 6% nos émissions en un an, par exemple. Donc ça, c’est…
Pas uniquement l’action d’un gouvernement, c’est une action, c’est le résultat d’une action très collective qui concerne les collectivités locales, les entreprises qui se mobilisent, aussi les citoyens à titre individuel. C’est tout ça ensemble qui fait qu’on a réussi à accélérer et ça, je pense que du coup, c’est un point important.
Alors après, je ne suis pas aveugle non plus et donc on voit que dans le contexte actuel, on a deux grandes choses qui nous arrivent très fort. La première, c’est qu’on voit…
Dans le débat politique et le débat médiatique, ce sujet de la transition écologique, aujourd’hui, là, à date, au mois de mars 2025, il a quasiment disparu. Il est très peu présent.
Et c’est pour ça qu’un certain nombre de médias titrent le grand renoncement. Derrière ça, je pense qu’il y a plusieurs éléments.
Il y a un premier élément qui est une forme d’effet de sidération face à la situation géopolitique mondiale, à la guerre, à nos frontières. aux actions, aux décisions de Donald Trump en matière de commerce international, en matière de politique internationale plus généralement. Et donc, face à cette considération-là, cette urgence-là, l’actualité en matière d’environnement a été rétrogradée.
Je pense que c’est une erreur, et je pense que les fondamentaux derrière la transition écologique doivent conduire à ce que ça se rééquilibre. Je m’explique.
On est pour l’instant très focalisés, à juste titre, sur… Le sujet de la guerre physique, le combat, l’Ukraine, ce qui s’est passé aussi bien sûr à Gaza et puis les autres théâtres d’opération.
Mais il ne faut pas qu’on oublie quelque chose qui est très spécifique à l’Europe et à la France en particulier, qui est que nous, territoire, nous n’avons ni énergie fossile, ni matière première. Et donc de ce fait, l’ensemble de notre économie est très dépendante de ces ressources-là.
En France, par exemple, on parle souvent de l’électricité française, c’est important. Mais deux tiers de la consommation d’énergie finale en France, c’est encore des énergies fossiles, beaucoup des carburants, du gaz naturel, etc.
Et on importe quasiment tout. En France, en 2019, on a importé pour 70 milliards d’euros d’énergie fossile.
Ce prix, il est monté jusqu’à 130 milliards d’euros en 2023 parce que les prix avaient explosé à cause des conséquences de l’arrêt du gaz russe avec la guerre en Ukraine, etc. Et donc, c’est une dépendance économique qui est absolument massive.
Et on voit bien qu’avec maintenant les annonces récentes de Trump de guerre commerciale, on voit aussi avec la posture de l’État chinois, par exemple, sur l’accès aux ressources, aux minerais, on voit bien qu’on est en très grande dépendance, on dépend d’un pouvoir de marché très fort, de tous ceux qui nous entourent et dont nos alliances antérieures sont pour une certaine partie remises en question. Et donc la bonne réaction aussi en termes de politique économique, et là je ne suis même pas sur un enjeu climatique, je suis vraiment sur un enjeu économique, c’est de façon accélérée. à marche forcée presque, de réduire l’intensité de notre consommation de ces énergies fossiles et de ces matières premières de l’économie française et européenne.
Et ça, c’est un synonyme de transition écologique. Parce que réduire la quantité d’énergie fossile, c’est-à-dire avoir plus d’efficacité énergétique, substituer les énergies fossiles par de l’électricité ou par des bioénergies, c’est un synonyme de transition écologique réussie.
Et donc cette transition écologique, si je résume, c’est la condition nécessaire de notre résilience économique à nous, Français, Européens, et dans un monde de tensions commerciales beaucoup plus fortes demain, c’est donc un enjeu de survie économique aussi. Donc si je prends un pas de recul dans la situation actuelle que l’on vit, il est légitime du coup qu’on ait une focalisation de notre attention sur les enjeux de défense, et donc le débat est légitime et donc il est en train de se structurer, mais il doit se compléter d’un autre volet qui est vraiment un volet de résilience économique.
Et c’est toute une urgence qui est tout aussi forte que celle de se préparer à notre défense physique, qui est celle de rendre plus robuste notre économie en étant sobre en intrant, et donc en réussissant cette transition écologique.
Thomas Gauthier
Je vais tenter une reformulation forcément raccourcie, forcément imparfaite de ce que vous avez dit, et ce que j’ai retenu. La fabrique de la décision publique en France est largement imprégnée d’une lecture lucide. des sous-jacents biophysiques, en matière d’approvisionnement en combustible fossile.
On se rend bien compte, vu la dépendance française à l’égard des pays producteurs de combustible fossile, qu’on a tout intérêt, économiquement, politiquement, géopolitiquement, à être autonome en énergie. Là où j’ai plus de peine, et j’ai une question ouverte du coup pour vous parce que je n’ai pas la réponse.
Avez-vous déjà pu constater dans votre vie professionnelle des signes vous indiquant que la fabrique des stratégies d’entreprise est elle aussi sur le point, ou alors déjà largement, dans un mouvement de… pleine préoccupation pour la biophysique. J’entends bien tout ce que vous avez dit sur la décision publique, et par ailleurs les arguments vont dans le sens, à l’échelle française par exemple, d’une préoccupation pleine et entière pour la biophysique.
Mais quid des entreprises qui n’ont pas forcément le même terrain de jeu que le terrain national français, quid par exemple des entreprises du CAC 40 qui assez largement, une étude récente de l’Institut français du gouvernement des entreprises l’a démontré, ne sont pas à actionnariat français en majorité. Qu’en est-il ?
Antoine Pellion
Alors, c’est une bonne question. L’angle des entreprises, il est double.
Une grande partie d’entre elles se pose aussi ces questions d’accès à l’énergie. Parce que généralement, c’est tout notamment l’industrie lourde, parce que le transport des marchandises produits est quelque chose qui peut être difficile ou coûteux.
Et donc de ce fait, les usines sont localisées quand même assez proches des centres de consommation. Et donc de ce fait, il en faut en Europe. quelles que soient les évolutions géopolitiques et économiques.
Et donc, l’accès des Européens, du territoire européen à l’énergie est un enjeu de préoccupation pour ces entreprises. Donc, ça concerne, si on est lucide, une petite partie des entreprises, mais ça existe déjà. Ça se double aussi d’un autre enjeu qui est d’accès aux matériaux.
On voit bien que sur des enjeux de lithium, sur des enjeux de plastique, de ciment, etc. se posent de plus en plus des questions de chaînes d’approvisionnement et de leur sécurisation. Et donc, de ce fait, il y a un enjeu aussi économique pour les entreprises en question à se poser ces questions de souveraineté-là.
Alors, pour l’instant, le problème, entre guillemets, c’est qu’il est double. C’est à la fois qu’il y a des chocs ponctuels qui arrivent, et donc du coup, ce sujet est une priorité pour l’entreprise à un moment donné.
Parfois, il ne l’est plus quelques mois plus tard, on l’a vécu. Je l’ai observé, par exemple, sur la question du gaz naturel.
Beaucoup d’entreprises très dépendantes au gaz naturel, dans la foulée de l’arrêt du gaz russe et de l’explosion des prix, ont accéléré leurs investissements dans des alternatives aux énergies fossiles. Certaines d’entre elles ont mis du temps à les faire.
Maintenant, les prix du gaz ont baissé. Elles se réinterrogent.
Et peut-être certaines ont décalé l’investissement, alors même que c’est celui qui, si la situation se redurcit demain, pourrait les sauver économiquement. Et donc, on manque encore un peu de… continuité dans l’action, et ça je pense que c’est un point important.
Et puis après, les signaux économiques, sur notamment la question des matériaux, de l’accès aux matériaux, ils sont encore un peu instables. Et donc de ce fait, face à une grande volatilité, les entreprises hésitent aussi là-dessus.
Donc il y a tout un enjeu dans les politiques publiques, à la fois françaises et européennes, de stabilité et de lisibilité de long terme pour pouvoir donner ces incitations-là. Mais là-dessus, la biophysique est assez claire pour en revenir à ça.
C’est-à-dire que ma conviction, c’est que ça se pose dans les mêmes termes pour les entreprises et pour les États. Et donc, de ce fait, on devrait arriver à la même conclusion et le même type d’alignement de l’action.
Là, vous avez raison, c’est que c’est probablement un peu plus mature, côté des États et de leur stratégie, que ça ne l’est du côté de la majorité des entreprises. Il y en a certaines qui sont plutôt en avance.
Et c’est lié aussi, peut-être dernier élément, à l’horizon de temps. de chacun des acteurs. L’horizon de temps à deux ans, trois ans de l’entreprise, il ne révèle pas tout, entre guillemets, par rapport aux enjeux sur la disponibilité des matériaux et de l’énergie.
Là où un certain nombre d’États voient plus loin structurellement et donc intègrent plus ces problématiques-là. Et dans tout ça, on n’a pas parlé du changement climatique, parce que d’ores et déjà, changement climatique, il a des effets aujourd’hui.
Il est aussi une des raisons des chocs qui, du coup, s’appliquent sur l’économie, les entreprises. On a vu Valence, les inondations. des chaînes d’approvisionnement qui étaient perturbées.
On pourrait parler aussi du secteur agricole et du fait qu’aujourd’hui, les rendements agricoles, quand il y a eu une baisse de rendement, c’est quasiment systématiquement parce qu’il y a eu un choc climatique, une sécheresse, une inondation, et qui a conduit à une baisse de rendement.
Thomas Gauthier
On va terminer cette première partie de l’entretien, cette première partie prospective peut-être, avec une cible d’auditrices et d’auditeurs en particulier, les étudiants et les étudiantes. D’après l’expérience que vous avez de ce public, Où situez-vous leur degré de… connaissances, voire de préoccupations pour une lecture biophysique de l’environnement ?
Et quels seraient, juste là aujourd’hui, vos conseils en matière d’enrichissement des formations qui sont proposées à ces étudiantes et à ces étudiants pour que la lecture biophysique ne soit pas une option, mais soit un fondement ?
Antoine Pellion
Alors ce que j’observe, c’est que pour l’instant, cette formation à la lecture biophysique des choses, elle est relativement peu répandue. Et donc de ce fait, c’est un axe d’amélioration très fort. et c’est Une invitation aussi à toutes les étudiantes et étudiants qui nous écoutent à aller s’y plonger.
Parce qu’en réalité, au-delà des enjeux strictement économiques, au-delà des sujets de réglementation politique, au-delà aussi des enjeux sociétaux, c’est indispensable de comprendre les sous-jacents physiques pour prendre les bonnes décisions ensuite. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’enseignements qui portent sur l’approche juridique de cela, sur l’approche économique, à la fois macro et puis aussi micro de rentabilité au niveau des entreprises. sur aussi les phénomènes sociaux qui sont autour, et avec parfois de complexité, entre guillemets.
D’une part, mais je pense que ce n’est pas que les étudiants, c’est nous tous aussi qui sommes concernés, on est sur des matières complexes sur lesquelles on lit beaucoup de choses, et parfois plus ou moins justes, et donc de ce fait, j’invite chacun à retrouver aussi les ordres de grandeur, de qu’est-ce qui compte, qu’est-ce qui est prioritaire, qu’est-ce qui est secondaire. Et on voit que du coup, quand on se plonge là-dedans, on redécouvre beaucoup de choses sur la fin, qu’est-ce qui compte vraiment ?
Et on ne se focalise pas sur telle ou telle action qui est importante symboliquement, mais qui a peu d’effet dans l’effet sur le plan biophysique. C’est le premier point.
Et le deuxième point aussi, à se replonger sur, et je pense qu’on y reviendra aussi dans la suite, sur la sociologie de tout ça. C’est-à-dire que mettre en œuvre toutes les actions pour une rendition écologique réussie, c’est réussir à chaque fois… à constituer une équipe qui mélange les pouvoirs publics à la fois l’État, les collectivités, les entreprises, les citoyens.
Il n’y a rien qui est de la responsabilité seulement de l’État, seulement des collectivités, seulement des entreprises. Et on a toujours une responsabilité très partagée, ce qui rend le sujet complexe, mais qui doit aussi nous faire prendre du recul sur les simplismes en disant « mais en fait, finalement, si on n’arrive pas à ce grand renoncement, ça veut dire que les gouvernements ont renoncé » .
Le sujet, ce n’est pas que les gouvernements, le sujet, c’est tout le monde en réalité. Et c’est ça qu’il faut vraiment avoir en tête, il faut se méfier de ces approches un peu caricaturales et simplistes.
Thomas Gauthier
Changement de décor, vous voilà désormais archiviste. Selon vous, quel est l’événement clé, méconnu voire même inconnu, qui a marqué l’histoire et dont les effets se font encore sentir aujourd’hui ?
Antoine Pellion
Alors je vais revenir sur… Vous m’invitez à prendre un événement historique qui est méconnu, parce que du coup il y a beaucoup de jalons qui sont très connus, et donc j’ai été aussi rechercher un élément qui me paraît très structurant.
Je vais prendre un élément, une date, 1947. Cette date, elle correspond à un événement important qui est qu’en France, c’est le premier plan comptable général que l’on met sur la table.
Donc la façon de compter les euros, l’économie pour les entreprises et pour les pouvoirs publics dans le début de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Alors ça fait écho à des travaux qui se sont déroulés pour partie d’ailleurs pendant l’occupation et puis ce sont des travaux qui préexistaient. mais c’est la première fois où vraiment…
On l’organise en France, on le structure et il va être extrêmement déterminant dans la façon dont on va structurer l’action collective, parce qu’il s’agit aussi de coordonner les acteurs, là dans une phase où il y a eu besoin d’un plan, qui est la phase de la reconstruction. Je sais que vous avez invité il y a peu de temps Alexandre Rambaud aussi, qui est longuement revenu sur les enjeux de comptabilité.
Donc je ne reviendrai pas sur tout le détail, même si je souscris beaucoup et j’invite d’ailleurs les auditeurs à lire, à écouter le podcast d’Alexandre Rambaud. Je dis ça parce que ça a conduit à structurer l’ensemble de nos décisions collectives, à la fois des pouvoirs publics et des entreprises, sur un prisme, en réalité, une lecture physique qui est très orientée sur une façon de compter les activités, l’économie, etc.
Et ça a des effets jusqu’aujourd’hui, puisque c’est aussi la façon dont encore aujourd’hui, même s’il y a eu quelques évolutions ultérieures, On structure la façon de compter les choses. Et or, et ça fait lien avec la première partie de notre discussion, on est maintenant dans un univers qui a changé, où la biophysique et les limites physiques, en la fois en matière d’eau, de biomasse, en matière de matériaux, elle est de plus en plus prégnante.
Et on est passé donc du coup d’une phase, après, de reconstruction, où l’enjeu c’était, on dispose de ressources, mais il faut les assembler, il faut reconstruire l’économie, à une phase qui est assez différente, où on a maintenant… des quantités limitées qu’il faut réussir à allouer, à répartir, et il faut s’assurer, coordonner l’ensemble des activités économiques entre elles de façon à pouvoir se répartir ces quantités limitées biophysiques dont nous disposons. Et donc derrière ça, on est aujourd’hui à un moment où on a besoin de réinventer aussi une façon de compter, une comptabilité.
Alors il y a plusieurs travaux sur le sujet, il y a des comptabilités multi-capitaux où on compte non seulement les euros, mais on compte aussi le capital environnemental, le capital social notamment. Je vais vous donner un exemple pourquoi c’est important.
C’est que quand on regarde par exemple la décarbonation, donc baisser les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports à longue distance, de l’aérien, du maritime, des transports de poids lourd sur des grandes distances, pris séparément, chacun des secteurs a un plan excellent de décarbonation qui arrive à baisser les émissions fortement à l’horizon 2030 et à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. La plupart de ces plans d’action, c’est vrai dans le maritime, c’est vrai dans l’aérien, Elle s’appuie notamment sur l’utilisation de biocarburants.
Et donc ces biocarburants, pour les produire, il faut qu’on utilise une quantité de biomasse, qui vienne de nos terres agricoles, qui vienne de nos déchets sur les champs, qui vient aussi de nos exploitations forestières. Et je vous l’ai dit auparavant, cette biomasse est en quantité limitée.
Et donc quand on sort simplement du secteur du maritime ou de l’aérien, qu’on regarde l’ensemble de l’économie et qu’on regarde l’ensemble des besoins en biomasse, En réalité, il n’y en a pas assez pour tout le monde. Et donc de ce fait, parce que oui, il y en aurait assez pour décarboner uniquement l’aérien ou uniquement le maritime, mais il n’y en a pas assez pour à la fois décarboner ces deux secteurs, et puis en plus contribuer au sujet des poids lourds, et puis en plus produire plus de biomatériaux, et en plus maintenir des puits de carbone, et donc des arbres sur pied qui pompent le carbone de l’atmosphère, et satisfaire en même temps les besoins alimentaires, et puis dernier usage aussi sans… pour dégrader la qualité organique des sols, parce que la biomasse qui pousse, il y a une grande partie qui doit rester au sol, pour pas que les terres s’appauvrissent.
Parce que si on prélève toute la biomasse qui pousse, demain on aura des terres qui deviendront infertiles. Et donc de ce fait, on aura vis-à-vis des générations futures, du coup hypothéqué extrêmement fortement l’avenir.
Et donc on voit bien qu’au-delà des… Et ça, les euros, ils ont un peu de mal à résumer, à expliquer, à donner les bons signaux de coordination de tout ça.
Et donc on doit développer une forme de langage commun. et de mesures communes qui nous permettent à la fois d’avoir, d’identifier les bons sujets, donc une nomenclature commune, à la fois de les quantifier, de se dire j’ai le droit d’en utiliser combien, c’est quoi les impacts, etc. Et donc ce langage commun, on a des parties qui existent, mais il n’est pas encore complet, il faut terminer de l’inventer.
Et ça, c’est extrêmement structurant pour notre réussite collective.
Thomas Gauthier
Je vais revenir du coup à cette année 1947 et à cette époque plus généralement. Vous l’avez dit, le plan comptable général a été extrêmement structurant pour la reconstruction du pays à la suite du second conflit mondial.
Ce qui a été aussi à cette époque-là extrêmement structurant, me semble-t-il, c’est la mise en place du commissariat au plan, d’un effort gigantesque à l’époque de construction de filières industrielles françaises, qu’il s’agisse de l’aéronautique, qu’il s’agisse du ferroviaire, qu’il s’agisse du nucléaire civil. On en est où aujourd’hui en 2025 ?
Des ambitions de planification ? industrielle, est-ce que nous avons des héritiers qui sont, selon vous, au juste niveau de fonctionnement dont on en a besoin aujourd’hui en France et en Europe ? Et peut-être une question complémentaire, comment on fait tactiquement pour être, comme l’est me semble-t-il la France, c’est-à-dire le bon élève de la classe, et en même temps ne pas subir, parce qu’on est dans un jeu de rapport de force international, ne pas subir une pression insoutenable de la part d’autres pays ? qui décrète du jour au lendemain que l’anthropocène a quitté la Seine.
Comment on fait pour rester bon élève et ne pas se retrouver dans une sorte de défaillance tactique que semble avoir en partie pointé du doigt Mario Draghi dans son rapport désormais célèbre ?
Antoine Pellion
Alors je commence par cette deuxième question, puis je reviens plus généralement sur le rapport au plan, au commissariat au plan, ce qu’il faut et ce que l’on a aussi en France. Je pense que sur votre cannaire question…Je pense que l’Europe est très particulière, et donc de ce fait, c’est notre, je vous l’ai dit juste avant, un jeu de survie économique, et donc c’est très existentiel en réalité pour la France, pour l’Europe en particulier, de réussir à rentrer pleinement dans cet anthropocène, et donc du coup de réussir cette transition écologique, sinon on a un vrai enjeu de survie, à la fois économique notamment.
Et donc de ce fait, je pense que ça, ça doit nous conduire. Et on commence à l’être de plus en plus lucide là-dessus et à agir résolument, indépendamment presque de ce que…
Encore plus, plus les menaces extérieures sont fortes, plus il est urgent d’agir et d’être efficace pour arriver à gagner en résilience économique. Et c’est assez normal en réalité que d’autres géographies n’aient pas le même raisonnement que nous.
C’est-à-dire que les États-Unis de Trump, ils ont assis sur des quantités énormes de gaz et de pétrole. L’économie chinoise, c’est la première économie mondiale en matière de… raffinage de matières premières.
Et donc, de ce fait, ils sont assis sur un énorme stock de ressources naturelles. Nous, l’Europe, on n’a pas tout ça.
Et donc, de ce fait, on se pose les questions différemment. Il ne faut pas qu’on rentre dans le jeu mondial, parce qu’on est plein dedans, avec notre propre approche et nos particularités.
Et donc, ça, pour réussir, et c’est possible, il faut qu’on fasse évoluer nos procédures industrielles, etc., pour qu’à la fois, on continue à produire, mais en consommant. moins de matières premières et donc du coup en étant beaucoup moins dépendant du pouvoir de marché des Etats-Unis et puis des pays asiatiques pour ne citer qu’eux je pourrais citer aussi les pays en fait du Moyen-Orient qui sont producteurs de pétrole l’enjeu aussi est le même là-dessus alors je reviens maintenant plus largement à l’analogie avec l’après-seconde guerre mondiale et puis le commissariat au plan. Alors Je pense qu’on a gardé en réalité en France une forte culture de planification à la fois nationale et aussi locale.
C’est-à-dire qu’il ne faut pas oublier que les collectivités locales à leurs différents niveaux, les régions, les départements, les intercommunalités jusqu’aux communes, elles sont toutes dotées d’un certain nombre de plans pour essayer de se projeter sur les évolutions à venir et la façon dont on les prend en compte. D’ailleurs probablement trop de plans, et c’est un des enjeux aussi, pas bien coordonnés, beaucoup trop nombreux, et probablement qui sont devenus au fil des temps des obligations de moyens plus que des outils pour pouvoir piloter les résultats.
Généralement, maintenant, on fait des plans pour cocher les cases parce que la loi, le règlement, etc. nous dit qu’il faut tel et tel plan. On les empile et on se pose moins la question à la fin de « est-ce que tout cela a du sens ?
Cela nous servira à quoi ? » etc. Un chiffre intéressant, il y a à peu près 9 milliards d’euros qui sont dépensés par les collectivités locales en bureau d’études pour pouvoir faire des plans divers et variés.
C’est ça l’ordre de grandeur sur les environnements. Donc là, on se dit, quand on dit ça, il y a probablement moyen de nettoyer tout cela et remettre un certain nombre de choses à plat.
Pour autant, ça traduit aussi le fait qu’on a une culture forte de planification qui est restée présente. Alors, ce qui a été la caractéristique du commissariat au plan et donc juste de l’après-guerre, c’est la très forte intégration du travail de planification, qui est en fait assez semblable à celui que je vous décris du SGPE, qui est de se dire finalement où sont nos objectifs, quelles sont les trajectoires.
Quelle filière économique on crée avec des ressources qui sont en quantité limitée et comment on fait pour y arriver ? Et la décision politique, parce que je pense que c’est un point important qu’une planification, ça a du sens.
Non pas seulement parce que c’est écrit et que c’est formalisé, mais aussi parce que c’est intégré à la façon dont les décisions politiques sont prises. Et ça, c’est un point qui est très important.
Et donc, on a eu plusieurs phases. donc une phase de la vie initiale du commissariat au plan, où il y avait vraiment une très forte intégration entre le politique et le commissariat au plan, et donc quelque part des choses qui se nourrissaient très bien entre l’analyse biophysique, économique, et puis les décisions politiques. On a eu ensuite, riche de tout ce que cela a permis de construire, une phase où finalement tu es très orienté marché, en se disant, quelque part, le fonctionnement beaucoup plus libre du marché est suffisant pour coordonner les acteurs.
Et donc, de ce fait, un peu une mise en retrait du plan tel qu’il avait été initialement lancé dans l’après-seconde guerre mondiale, à la fois dans son élaboration, donc une activité commissariale au plan a largement évolué, et puis dans la façon dont il était utilisé pour les décisions publiques. Et là, on a une forme de retour au plan, entre guillemets, qui est en train de s’opérer, et qui s’explique assez bien parce qu’en fait, on est aussi face à des crises nouvelles.
Et un plan, en fait, qu’est-ce que c’est un plan ? C’est quand on est sur des changements très profonds qui nous secouent énormément.
Et là, on a la démographie, le numérique, l’énergie, l’écologie, le changement climatique, tout cela. On voit que dans un monde où tout est très complexe, on a du mal à comprendre dans cette complexité-là quel est le chemin.
Donc, on a besoin de lisibilité et donc d’avoir un narratif, un récit commun. Et là, le plan revient, entre guillemets.
Et il est là pour pouvoir construire ce récit, trouver cette voie. L’explicité est un élément de coordination. de l’ensemble des Par rapport à ça, ce que l’on a construit avec le SGPE, c’est non seulement une équipe qui se préoccupe de la biophysique, de décrire les trajectoires, etc.
Mais c’est surtout une fonction qui a été confiée aux premiers ministres successifs. En 2022, Emmanuel Macron, dans l’entre-deux-tours des présidentielles, a un discours à Marseille en disant l’importance de la transition écologique et le fait que la coordination de tout cela soit une mission explicite du premier ministre.
C’est la seule mission qu’il a. En plus du reste, il est Premier ministre, il coordonne toutes les politiques publiques, et en plus de ça, il est en charge de la planification écologique.
Pour l’histoire, c’est quelque chose qui avait existé une seule fois dans l’histoire française, c’était pour la création de l’école publique obligatoire, avec Ferry à l’époque, et donc il était Premier ministre, et il était aussi en charge de l’éducation nationale. Et donc, on fait l’analogie, ça montre que c’est un sujet politique essentiel.
Ce SGPE, il a été créé directement auprès du Premier ministre. Ça a commencé avec Elisabeth Borne en 2022. Et concrètement, avec Elisabeth Borne, avec l’ensemble du gouvernement à l’époque, on a eu des séances de plusieurs fois deux heures, thème par thème, sur lesquelles on rentre dans les enjeux biophysiques, les conséquences en termes de décisions publiques.
Et on sort de ces réunions en se disant, voilà la trajectoire qu’on se fixe politiquement, voilà les mesures que politiquement on assume et qu’on va porter pour pouvoir garantir l’atteinte de la trajectoire. Et donc on a vraiment un mécanisme. institutionnel qui nous permet d’allier la connaissance technique et la décision politique.
Alors ce mécanisme, après, il faut le faire vivre. Et donc c’est ça aussi tout l’enjeu, de le faire traverser les différents gouvernements, les différentes configurations.
Et c’est ça vraiment qu’on cherche à faire. Donc on retrouve, en quelque sorte, l’essence du plan.
Et puis je termine par un point qui est que, je parle beaucoup du niveau national, mais bien sûr que… encore plus dans le monde d’aujourd’hui, parce qu’il y a eu, entre-temps, depuis 1947, il y a eu des lois de décentralisation très fortes. C’est une action collective qui implique aussi beaucoup les collectivités locales.
Et notamment, ce qu’on a mis en place au SGPE, c’est ce qu’on appelait les COP régionales, par analogie avec les COP climatiques et l’ensemble des États qui se réunissent pour pouvoir définir quelle est l’action mondiale. Là, c’est l’ensemble des acteurs au niveau d’une région donnée qui se retrouvent autour de la table en se disant Concrètement, notre trajectoire à nous, région Normandie, région Centre-Val-de-Loire, région PACA, pour pouvoir répondre à la fois aux enjeux de gaz à effet de serre, mais aussi de biodiversité, d’économie, etc.
Voilà ce que c’est. Voilà les outils, les leviers, les trajectoires année par année.
Et puis, du coup, quelles sont les actions opérationnelles qu’on prend. Et dans cette dimension de COP régional, là aussi, la façon dont on structure le discours, la façon de compter, etc.
Et donc ce sujet… que j’évoquais tout à l’heure de normes comptables, l’évolution de la comptabilité vers du multi-capito, il est aussi très nécessaire, parce qu’encore plus nécessaire, parce qu’on est sur un nombre d’acteurs et de gens qui prennent des décisions encore plus importants, donc plus que jamais, on a besoin d’avoir un discours commun, des outils de mesure communes, pour pouvoir se coordonner.
Thomas Gauthier
Là encore, je tente une reformulation encore plus succincte que la précédente. Ce que j’entends des travaux jusqu’ici et en cours du secrétariat général à la planification écologique, c’est que Merci.
En l’absence d’une telle instance, finalement, la transition écologique se réduit à l’adjonction à un vocabulaire qui existe déjà de nouveaux mots. Et le secrétariat général à la planification écologique, comme outil, vise le dépassement de ce simple enrichissement de vocabulaire pour fabriquer des nouvelles règles de grammaire.
Parce que la grammaire doit être respectée à travers ces différentes règles. et on arrive à comprendre qu’il y a un lien étroit entre survie économique et survie biophysique, qu’à la condition que cette grammaire soit en fait déployée au sein des différents services de l’État, au sein des différentes entreprises, et que l’on n’oppose plus quelque part, à nouveau, un enrichissement sémantique avec des nouveaux mots qui nous parlent de transition écologique, mais nous basculons alors vraiment vers une nouvelle grammaire. On arrive à la dernière question.
Vous êtes désormais acupuncteur, mais alors un acupuncteur sobre en ressources, puisque vous n’avez qu’une seule aiguille. Quelle serait d’après vous la décision, l’action, l’intervention qui pourrait contribuer significativement à la fabrique d’un monde habitable dès à présent ?
Antoine Pellion
Alors, mon aiguille, elle est un peu baguette magique, dans ce que je vais vous dire. Mais moi, si j’avais vraiment cette baguette magique pour une seule action, je pense que le plus important, c’est que chacun…
Donc nous tous individuellement, mais aussi les chefs d’entreprise, les signants publics, etc. regagnent confiance en soi sur la capacité d’agir justement sur ces enjeux de transition écologique. Pourquoi je dis ça ? Ça peut paraître un peu bateau, mais tous nos travaux de planification montrent qu’il n’y a aucune solution magique qui permet de tout résoudre et il faut qu’on arrive à faire plein de choses en même temps.
Ils montrent aussi qu’il n’y a pas un seul acteur qui est en responsabilité, c’est à chaque fois un peu tout le monde. Pour donner un ordre de grandeur, sur les baisses de gaz à effet de serre d’ici 2030, la moitié, 50% des baisses, sont directement liées à l’action des entreprises individuellement. en matière d’industrie, de logistique, etc.
Un quart sur les pouvoirs publics, qui, du coup, définissent l’urbanisme, etc. Et un quart sur les ménages, vous et moi, à titre individuel.
Donc, on voit que c’est très réparti, en réalité, cette action-là. Donc, un, il n’y a pas d’action magique qui fait qu’on règle tout d’une coup de baguette magique.
Deux, c’est très réparti. Et trois, en réalité, et ça, c’est quand même une bonne nouvelle, c’est que non seulement il y a un chemin, c’est qu’on a montré avec nos travaux qu’on pouvait y arriver en alignant toute une série d’actions en mobilisant les acteurs.
Mais ce chemin-là… Il peut se faire de façon non brutale, entre guillemets, et donc en respectant aussi un certain nombre de règles de justice, d’équité, et que ça ne nécessite pas d’avoir tout révolutionné dans les trois prochaines années pour y arriver.
Et donc, en d’autres mots, c’est possible, mais il faut y croire. Et or, on est souvent, moi-même à titre individuel, des fois plongé dans une espèce de considération un peu vertigineuse qui est face au dérèglement mondial. à ces enjeux géopolitiques qui nous dépassent, on se dit, moi, individu, ou moi-même entreprise, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que j’agisse ?
Et donc, il faut vraiment qu’on regagne cette confiance en soi, parce que oui, non seulement c’est utile, mais en plus, si on le fait tous, on y arrive, c’est possible d’y arriver. Et ça, c’est vraiment extrêmement structurant, me semble-t-il, extrêmement important.
Et on y arrive, non seulement pour sauver la planète, et donc nous tous, mais on y arrive aussi, et ça a des conséquences très immédiates, et presque égoïstement, pour chacun d’entre nous. Ça a des bénéfices en matière de santé, ça a des bénéfices en matière aussi de pouvoir d’achat en réalité, ça a des bénéfices en matière, je l’ai dit, de souveraineté économique pour une nation et donc quelque part aussi de notre autonomie. On n’a pas envie du coup que ça soit Donald Trump qui nous dicte les règles du vivre en commun demain ici en France et en Europe.
Et donc c’est tout ça qui est en train de se jouer. Donc voilà si j’avais cette baguette magique.
Thomas Gauthier
Et alors cette baguette magique, malheureusement je ne suis pas là pour vous l’offrir. Par contre j’aimerais bien que vous… témoigner un instant de la suite que vous avez donnée d’ores et déjà à votre engagement personnel après avoir quitté le secrétariat général à la planification écologique il y a quelques semaines.
Parlez-nous un instant de cette association qui monte.
Antoine Pellion
Alors, on a fondé à plusieurs d’entre nous une association qui s’appelle la planification écologique que vous pouvez retrouver sur internet, agir-planification-écologique.fr et qui regroupe en réalité toutes celles et ceux … qui se posent la question de leur action, à la fois à titre individuel, mais aussi de projets collectifs qu’ils veulent mener pour pouvoir réussir cette transition écologique. Et donc on est d’ores et déjà plus de 300 à avoir rejoint cette démarche.
Et donc très concrètement, par cette association, on fédère celles et ceux qui veulent agir sur plusieurs segments concrets. Le premier, c’est un enjeu à la fois de formation à l’action individuelle et collective.
Vous connaissez, je pense, bon nombre d’entre vous, la fresque du climat et ses ateliers. Il y a un autre atelier qui a été conçu par le SGPE et déployé par cette association de planification écologique qui s’appelle Le Bon Plan.
Vous le trouverez sur le site internet. C’est le même format, à peu près une dizaine de personnes, un atelier de deux heures.
Et là, les petites cartes, ce n’est pas la biophysique du changement climatique, c’est les actions concrètes que l’on doit mener pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi protéger la biodiversité. réussir la transition de l’économie circulaire, etc. Ça permet de toucher l’action concrète, à la fois individuelle, collective, de naviguer dans ces enjeux d’ordre de grandeur. On parlait beaucoup de biophysique dans ce podcast, mais aussi des enjeux de ressources limitées, parce que je n’ai pas assez d’eau, pas assez de biomasse, pas assez d’énergie pour tout faire.
Et donc, de toucher tout cela du doigt. Et ça, c’est très important, non seulement pour nos étudiants, comme on en parlait, pour les décideurs en général, en entreprise, dans les autorités publiques, qu’elles soient locales ou nationales.
Donc vraiment un enjeu autour sensibilisation, formation. Il y a un deuxième enjeu dans cette association qui est d’accompagner l’action collective locale.
Donc je vous ai parlé des travaux de planification qu’on menait avec le SGP au niveau régional. Donc comment on travaille avec les régions, les départements pour pouvoir trouver les leviers d’action.
Dans l’association, on va travailler une autre échelle qui est une échelle plus locale, l’échelle de l’intercommunalité et de la commune. parce que là Il faut pareil qu’on trouve la bonne grammaire, pour reprendre le terme de tout à l’heure, qui permet de bien articuler l’action très locale avec le plan régional ou le plan national. Et ça va être utile, notamment, j’en suis sûr, dans les prochaines, notamment, échéances électorales.
Les prochaines, c’est les élections municipales. Le but étant notamment ici de pouvoir doter le plus grand nombre d’outils de compréhension de ce qui se passe pour pouvoir se faire sa propre opinion et y contribuer le cas échéant.
On va aussi déployer avec l’association un nombre d’outils très concrets d’accompagnement à l’acte individuel. Peut-être que vous connaissez un outil très bien fait de l’ADEME qui s’appelle Nos Gestes Climat, qui permet à chacun de mesurer son empreinte carbone.
Mesurer son empreinte carbone, c’est la première étape. Derrière, ce qu’il faut se dire, c’est comment j’agis pour pouvoir baisser mon empreinte.
D’ailleurs, c’est carbone, mais environnementalement, plus généralement, sur l’eau, etc. Et donc, avec ce petit outil qui est d’ores et déjà en ligne, téléchargeable sur toutes les bonnes… sur tous les stores, donc ça s’appelle J’agis, vous avez non seulement des propositions de passage à l’action individuelle, et là l’objectif c’est d’assumer qu’il peut y avoir des petits pas, et que c’est pas mal de faire des petits pas, et que du coup c’est la somme des petits pas qui fera les grands pas, et qu’on va arriver collectivement.
Et puis vous trouverez aussi à cet outil-là un portail unique vers toutes les aides publiques qui existent pour accompagner le passage à l’action, non seulement celles de l’État, mais aussi des collectivités. Vous habitez par exemple à Nogent-le-Rotrou, vous savez que…
Il y a l’aide de l’État qui apporte tant sur les véhicules, mais aussi la région Centre-Val-de-Loire, mais aussi le département de l’Eure-et-Loire, et puis la commune en particulier. Donc tout cela est réuni sur un même endroit.
Voilà, quelques exemples concrets. Il y en a bien d’autres, mais j’invite aussi toutes les auditrices et auditeurs à consulter ça. Ça mène à un point pour moi important, qu’on n’a pas assez dit dans cette longue discussion, mais qui est vraiment très structurant, qui est, il faut bien se rendre compte, qu’on est sur des changements d’extrêmement grande ampleur qui vont nous bousculer dans notre quotidien, notre façon de vivre, etc.
Mais pour autant, il existe une façon de le faire progressive. Et ça, c’est très important de le dire, parce que ça explique une grande partie de ce backlash écologique qu’on est en train de subir aujourd’hui.
Il y a beaucoup d’acteurs qui caricaturent très vite l’écologie en disant que c’est ces gens qui veulent vous empêcher de rouler en voiture, de manger de la viande. qui veulent vous imposer de faire des énormes travaux dans votre maison, vous n’avez pas les moyens, etc. Et on a l’impression, quand on écoute ça, qu’on doit tout faire tout de suite, et donc ça paraît une montagne, ça paraît quasiment impossible.
La réalité, et c’est ce qui est mis dans le plan, c’est que ce changement est progressiste. L’ordre de grandeur, par exemple, sur les voitures, ce qu’on voudrait, c’est qu’il y ait 15% des Français qui aient une voiture électrique en 2030. Ça veut dire qu’en 2030, 85% des Français, quasiment la quasi-totalité de la population, aura toujours une voiture thermique, et ça n’est pas un problème.
C’est vrai aussi pour les logements. On parle de rénovation de logements, c’est important.
Mais dans le plan, pour qu’on réussisse, il faut qu’il y ait 12% de rénovation performante sur l’ensemble des logements de France en 2030. Ça veut dire aussi que 90% des logements n’auront pas encore été rénovés. Mais ça n’est pas grave, entre guillemets, parce que ça va s’étaler dans le temps.
Et cet étalement, il est possible parce que dans le même temps, on a été très exigeants, notamment avec un certain nombre d’entreprises, parce qu’elles ont été très vite sur la décarbonation. et ça, ça nous a laissé du temps à nous, citoyens, pour pouvoir… prendre le temps de faire les choses, quelque part, à notre rythme. Et donc, ce chemin, il existe, et donc il faut qu’on arrive à éviter toutes les fake news et puis toutes les caricatures qui sont faites de l’écologie qui sont créées, ces fake news et caricatures, elles servent à faire peur pour nous donner à la fois l’impression que c’est impossible, ou alors que ça va être invivable.
La réalité, elle est vraiment tout autre. Il faut qu’on sorte de ces caricatures, qu’on les défasse, c’est un enjeu de mobilisation générale, parce que ce chemin, il existe. il est progressif et il est juste.
Thomas Gauthier
J’ai l’impression Antoine, à l’issue de cette conversation, qu’il y a un état d’esprit qui ressort. C’est celui d’optimisme lucide et peut-être aussi un slogan.
Alors je ne sais pas s’il sera repris par l’association ou par vous-même, que j’emprunte un instant à l’association pour le logiciel libre en France, Framasoft. La route est longue, mais la voie est libre.
Merci Antoine.
























Pour commencer la réflexion sur la confiance :